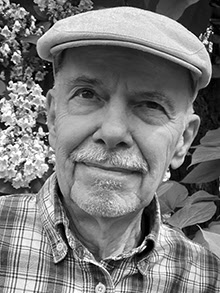ANDRÉ MAJOR continue son exploration du quotidien avec un sixième carnet intitulé « Entre chien et loup », une expression qui désigne le moment où la lumière, en fin de journée, ne permet plus de bien distinguer les objets. Il fait allusion à son âge, bien sûr. Parce que le temps passe, que la vieillesse se pointe à l’aube de ses 80 ans, qu’elle rôde sans oser s’approcher. J’en sais quelque chose, Major me précède de quelques pas dans la grande aventure de respirer, de traquer les mots envers et contre tous. Il partage sa vie entre Montréal et son chalet des Laurentides. Là-bas, il peut bricoler, marcher dans la montagne, contempler le lac qui change avec les saisons, entretenir son petit domaine en surveillant les arbres, choyer sa famille et préparer de bons repas. Et écrire, noter ce qui lui vient à l’esprit au jour le jour et, surtout, revisiter des écrivains qui ont marqué son parcours et orienté sa pensée. Son carnet couvre sept années, soit de 2008 à 2014.
Je me sens proche d’André Major, même si nous ne nous fréquentons pas. On se connaît, bien sûr, parce que nos chemins se sont croisés à quelques reprises. Comment faire autrement dans notre petit milieu des lettres au Québec ? J’aime surtout le lecteur qui éprouve le besoin de parler des écrivains qu’il affectionne et relit. Et il y a cette passion pour le journal personnel, le carnet que nous partageons. Je ne le mentionne pas souvent, mais je tiens un journal depuis des décennies et mes calepins noirs envahissent tout un rayon de ma bibliothèque. Je travaille à la main dans cette aventure, pour le plaisir du geste, pour une phrase sentie et physique. J’ai essayé à l’ordinateur, mais ça ne marchait pas. Je ne sais rien des rituels d’écriture de Major.
ÉCRIVAINS
« Entre chien et loup » fait une belle place aux écrivains et à certains ouvrages. Il a ses familiers qu’il prend plaisir à relire, à mieux connaître en plongeant dans des biographies et des textes qui concernent ses favoris. Kafka revient souvent dans ce palmarès, Thomas Bernhard, Thomas Mann, Anton Tchekhov, qui reste le phare qui a illuminé sa vie. Tolstoï, Robert Walser, Virginia Woolf, et bien d’autres.
« En lisant Flaubert, on a la sensation d’être emporté par un souffle puissant, même lorsqu’il étreint la banalité de l’existence, sans doute parce que chez lui le style embrasse la matière comme la marée avale le sable. Et cette sensation, on l’éprouve autant dans sa correspondance que dans ses œuvres. » (p.18)
Il y a les travaux au chalet, son havre dans les Laurentides et ses passages dans la ville où il se réfugie dans le parc le plus proche pour respirer, parler certainement aux arbres qui veillent sur lui. En tout cas, tôt le matin, je ne manque jamais de saluer les pins qui cernent la maison et qui réagissent aux humeurs du temps, aux caprices du vent, surtout, qui souffle souvent sur le lac Saint-Jean. Nous avons tous les deux la passion de construire, de réparer ce qui se brise, de tailler les arbres, de prendre soin des arbustes dont la floraison est la plus belle des récompenses. Ces petits gestes occupent tous nos étés.
ÉCRIRE
Bien sûr, l’écriture prend une grande place dans la vie de Major comme dans la mienne. C’est notre manière d’être, une façon de se tenir et d’avancer dans le monde qui s’offre autant qu’il se dérobe. Comment écrire, pourquoi écrire, que dire dans un carnet qui rejoindra quelques fidèles quand il deviendra un volume.
« La pure joie d’exister, il m’arrive de la ressentir à l’aube ou quand le soleil se couche. Je me contente de voir les choses vivre autour de moi. Et je me sens alors accordé à la vie, prêt à replonger dans le train-train quotidien. Ce qui n’arrive pas si fréquemment, surtout en ville où règne une certaine effervescence, dans les rues et même dans le ciel si on a la malchance de vivre sous les lignes aériennes. On a besoin d’espace autant que de silence pour bien voir en soi ou autour de soi. » (p.39)
Bien sûr, le réel le rattrape de temps en temps. Les moteurs hurlent l’été sur le lac, ces motomarines qui me font rager pendant les vacances de la construction, ces engins qui tourbillonnent du matin au soir sur le lac Saint-Jean. La pollution à l’état pur et une mécanique parfaitement inutile et superflue.
Je partage cette détestation avec lui.
Heureusement, ce n’est pas ce qui domine. Je pense à lui ce matin, en tendant l’oreille pour entendre les confidences des arbres, l’appel du huard, ou encore la symphonie des outardes qui me saluent lors de leur migration.
« Je me sens parfois si déserté intérieurement qu’il me fait ouvrir un des livres qui se trouvent à ma portée pour sentir le flux vital m’irriguer à nouveau l’esprit. C’est comme si j’émergeais d’une sorte d’absence ou d’égarement. Et alors, pour paraphraser Robert Walser, je peux écouter, m’arrêter et ne plus bouger, “divinement touché par de toutes petites choses” » (p.85)
André Major écrivait ce texte le premier mai 2009. Je me suis demandé ce que je pouvais avoir rédigé à la même date. J’ai fouillé dans mes carnets pour remonter le temps, ce que je ne fais jamais. Je m’attarde à un extrait, à ma calligraphie de fourmi que j’ai parfois du mal à décrypter.
« J’ai eu droit à un concert ce matin en allant chercher le journal. Bruants et crécerelles s’en donnaient à cœur joie. Parulines et sittelles si discrètes d’habitude, me semblaient plutôt joyeuses avec le retour du soleil. C’était un bonheur de chants et d’appels. Je respirais à m’en faire éclater la poitrine et c’était comme si je me berçais dans les cris des outardes qui ont passé la nuit dans la baie. Dans ce matin frais et calme, je me sentais là où je devais être. »
Et que penser des cauchemars d’enfermements et d’égarements de Major ? Combien de fois me suis-je retrouvé dans une ville étrangère, ayant perdu mes clefs et l’adresse de l’hôtel où j’étais descendu ? Incapable de parler, errant sur les trottoirs comme une âme en peine. Ou encore ces moments où j’étouffe au milieu de la nuit. Il faut me lever alors, bouger, ouvrir un livre pour m’apaiser. Bizarre de faire les mêmes cauchemars. Y a-t-il des rêves réservés aux écrivains ?
RETOUR
Et je me répète souvent qu’il serait temps de revenir sur mes pas, de me pencher sur des auteurs qui ont ouvert des portes et des fenêtres, ceux et celles qui m’ont montré la façon de dire qui j’étais et ce que je voulais devenir. Je pense à Marie-Claire Blais, Gabrielle Roy, Victor-Lévy Beaulieu, Jean Giono, William Faulkner, Erskine Caldwell, Gabriel Garcia-Marquez et Louis-Ferdinand Céline. Et oui, André Major, j’ai aussi fréquenté Thomas Mann, il y a bien des années, avec Herman Hesse et Malaparte, tout comme Gômez-Arcos. Il fut une époque où je ne jurais que par Tolstoï, Dostoïevski et Tchekhov.
Nous avons souvent emprunté les mêmes sentiers. C’est pourquoi je me permets de croire que tu es un ami, un proche. Nous ne nous ferons aucun geste pour changer cela, étant tous les deux un peu sauvages et capables de nous accommoder de la solitude pendant de longues périodes.
« Entre chien et loup » m’a encore une fois procuré de beaux moments de vie. Depuis que j’ai terminé ma lecture, je garde le livre sur mon bureau, l’effleurant du bout des doigts pour me rassurer et ne pas oublier. C’est certainement pourquoi je rédige des chroniques, pour répondre aux mots par les mots. Et je l’ouvre au hasard pour cueillir une phrase qui va m’aider à traverser la journée.
« Telle une vieille grange, je grisonne, mais je reste debout — pour combien de temps, ça reste à voir. » (p.213)
Le carnettiste m’a accordé le privilège, une fois de plus, de l’accompagner et de jeter un regard sur ma propre aventure, de constater l’importance qu’a pour nous la phrase juste qui va comme une musique qui touche l’âme. Quelle chance de pénétrer dans l’univers intellectuel d’un écrivain, d’un lecteur qui cherche du sens à la vie ! André Major parvient surtout à créer de la beauté dans son quotidien et à trouver des éclaircies dans la morosité de l’époque.
MAJOR ANDRÉ : « Entre chien et loup », Éditions du Boréal, Montréal, 232 pages, 27,95 $.
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/entre-chien-loup-4094.html