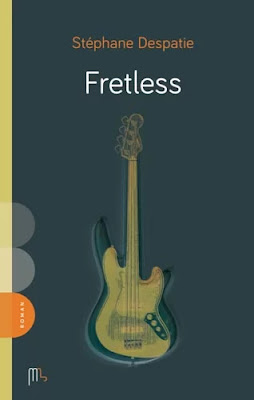RITA LAPIERRE-OTIS, dans L’infini du regard, un carnet, garde les yeux bien ouverts pour décrire le monde qui l’entoure. L’écrivaine récidive après m’avoir charmé en 2021 avec Territoires habités, territoires imaginés. Encore une fois, elle invite le lecteur à la suivre dans son petit et merveilleux univers. Celui des arts visuels qu’elle a exploré pendant des années, produisant des œuvres avec patience et ténacité, s’offrant même une apothéose au Centre national d’exposition de Jonquière. Comment nous rendre vigilants à tout ce qui nous voisine, habite notre espace et en fait sa plénitude et sa formidable densité ? Tout passe par l’œil qui nous permet de prendre conscience de soi et des autres, du monde qui nous entoure et nous permet la durée. Il faut ce regard pour se sentir vibrant, réceptif à la beauté que la nature sème autour de nous. Rita Lapierre-Otis se risque dans l’aventure de décrire la vie, nous donne l’occasion de rester attentif à son environnement et au nôtre. J’aime cette « femme à la fenêtre » qui observe les travaux des oiseaux, les chamboulements dans les arbres avec les saisons et aussi qui n’hésite jamais à faire un pas en arrière, quand une teinte dans le bouleau, une odeur ou encore un objet la ramène à son enfance et ses souvenirs. Il ne faut pas oublier non plus les grandes manigances du chat des voisins qui sait si bien se fondre dans le boisé derrière la maison.
Je répétais souvent, lors des ateliers que j’ai donnés au Camp littéraire Félix, qu’un écrivain est avant tout un lecteur du monde qui l’entoure. Un curieux insatiable aussi des auteurs, ses contemporains surtout, pour comprendre leurs regards sur son époque. Je n’inventais rien, m’inspirant des propos du frère Marie-Victorin qui affirmait ceci : « On ne possède pas un territoire qu’on n’a pas nommé. On ne connaît pas un territoire dont on ne connaît pas le nom. » Dire, décrire, peindre dans une certaine mesure ce pays dans ce qu’il est. Les plantes omniprésentes, les arbres pour l’ombre, les chants du vent, les bouchées de verdure du printemps et les tellement beaux coloris d’automne ; les oiseaux aussi qui surveillent nos jours et nos nuits, nous accompagnent parfois dans nos folles randonnées. Mettre le monde en mots, cet univers qui nous entoure avec les êtres courants, rampants, volants qui occupent tout l’espace. Tout cela pour être conscient de son environnement, de tout ce qui palpite et nous cerne, nous secoue et nous empêche de demeurer des touristes pendant toute notre existence. Nous passons si souvent dans nos petits pas, sans voir tout ce qui rend heureux, sans prendre la peine d’admirer la mésange qui s’accroche à la mangeoire ou encore, dans l’effervescence de l’été retrouvé, tout ce qui fleurit, pousse, éclate dans le boisé ou la cour arrière. Rita Lapierre-Otis nous apprend à ouvrir les yeux, à observer ce qui nous constitue.
« Je reviens à mon carnet d’atelier, ce grand album couvrant des sujets récurrents : le temps, les racines, l’identité, la nature du territoire, les arts visuels et l’environnement. Rassemblés, des écrits, notes, citations, croquis, dessins, collages qui font constater qu’on demeure profondément ce que l’on a été. Mais toujours de façons différentes. » (p.20)
Rita Lapierre-Otis est semblable au chat à l’affût de ce qui remue près de lui lors de ses expéditions quotidiennes. Je me suis déjà attardé à observer l’une de mes chattes dans l’univers qui s’étend autour de la maison, la suivant discrètement, m’arrêtant quand elle figeait, tentant de deviner ce qu’elle apercevait, ce qu’elle sentait et tout ce qui faisait bouger ses oreilles. Elle m’a permis d’être plus attentif aux froissements des feuilles, aux effluves qui flottent dans l’air en empruntant des chemins imprévisibles, les frémissements dans les herbes et peut-être aussi au bruit que fait une fleur de lilas en s’ouvrant. Une expédition qui m’a fait voir autrement le bouleau, les pivoines et les rhododendrons. Et l’appel du merle et de la corneille au loin, du chardonneret et de la tourterelle triste. Depuis, je réponds aux salutations des mésanges et aux visites des durbecs des sapins.
QUÊTE
Le quotidien de Rita Lapierre-Otis se fait quête où elle tente le plus souvent possible de « voir réellement » ce qui l'entoure et ce qui lui est si familier tout en restant inconnu. Les objets qui s’accumulent dans l’atelier et qui rappellent des moments d’enfance, l’époque où elle ouvrait les yeux et ses oreilles au monde. Des réminiscences aussi qui la suivent depuis toujours et qui font ce qu’elle est. Parce que nous sommes faits autant du passé, celui des parents et des ancêtres, que de nos propres aventures.
« C’est bien là, le mystère du temps. Mais inutile de vouloir suivre pas à pas les méandres de la mémoire. Et sait-on, avec le temps, ce qui a été rehaussé, enjolivé, idéalisé ou interprété ? Par ailleurs, ces histoires mnémoniques ne procurent-elles pas à “la dame qui écrit”, une matière souple et un large champ d’interprétations dans ce désir profond de réinventer son monde ? » (p.55)
C’est ainsi que j’ai accompagné « la femme qui regarde » pendant à peu près toute une année dans ses métamorphoses et ses surprises. Peu importe que ce soit pendant l’éclatement du printemps ou pendant l’effervescence enluminée de l’automne, Rita Lapierre-Otis s’efforce de demeurer attentive à toutes les petites choses qui nous suivent dans une journée. Le café matinal, une fleur qui s’ouvre dans sa couleur, les geais dans l’arbre, le chat en chasse, un livre qui traîne tout près avec une phrase qui la ralentit. Même quand la neige barbouille les cèdres et les épinettes du cran si souvent étonnant, elle est là, pleinement dans son regard. Toujours, malgré les humeurs du temps et les grâces du moment, il y a quelque chose à surprendre et à étudier pour l’artiste.
Bien sûr, il faut apprendre à respirer et à être dans toutes les frontières de son corps, dans le présent, sans se laisser distraire pour lire tout ce qui se transforme dans son jardin, allant à petits pas dans la galaxie qui jouxte sa maison, reconnaissant et saluant les fleurs qui s’épanouissent dans des petits cris d’émerveillement certainement, que seule la poète parvient à enfermer dans un haïku.
« douce odeur de forêt
pin sylvestre sapin beaumier
le goût d’un thé des bois » (p.60)
Il y a tant à découvrir. Les geais bleus si bavards et expressifs, les sittelles qui voient le monde à l’envers, les quiscales toujours un peu bruyants, les papillons, encore les perce-neige, et peut-être aussi un éclat de soleil dans les épinettes qui capte l’attention de l’artiste. Des moments de recueillement et d’apprentissage pour être tout droit dans son regard et son corps, dans l’instant même et pas ailleurs.
APPRENDRE
Voir, respirer, écrire en retenant son souffle pour ne pas effaroucher le monde vivant, se sentir toute là, les pieds sur le sol chaud, devant une pivoine qui se courbe, épuisée par sa beauté. Et pour laisser monter en elle les marées du souvenir, les grandes vagues qui éclaboussent les rives des Îles-de-la-Madeleine d’où viennent ses ancêtres. Le son du violon de sa mère quand elle s’abandonnait à la tristesse, à la mélancolie et les mélodies qu’elle jouait, celles apprises avec patience dans une enfance qui se recroqueville dans un album de photos.
« échos d’hier
dans l’aventure du carnet
l’enfance en partage » (p.112)
Un carnet formidable que L’infini du regard, un hymne à la création, un chant qui porte la splendeur de tous les matins du monde. Rita Lapierre-Otis voit, sait puiser dans les mots des autres une expression, une image qu’elle scrute comme une pierre précieuse. Parce qu’elle écrit en prenant son temps, tout lentement, debout à la fenêtre, devant un univers qui n’arrête jamais de la captiver. Attentive, là, concentrée dans son regard, dans son sourire certainement au plus chaud du jour et parfois de la nuit. Et aussi pendant une escapade avec des amis pour se frotter à la beauté du fjord du Saguenay, un paragraphe d’un livre qui ne cesse de l’émerveiller et de la combler. La carnetière a l’art de nous présenter ces moments qui rendent plus conscients de notre aventure d’être. Un calepin où elle médite et nous transmet son bonheur du monde. Même quand tout semble aller un peu de travers, elle sait se relever devant le miracle d’un autre matin qui s’impose en enjambant la tête des arbres. Avec ici et là, un haïku, comme une tranche de temps, une toute petite aquarelle. Mille fois merci à cette écrivaine qui permet de nous évader dans les merveilles quotidiennes, de se perdre dans l’abîme du regard.
LAPIERRE-OTIS RITA : L’infini du regard, Éditions L’instant même, Longueuil, 136 pages.
https://instantmeme.com/livres/l-infini-du-regard/