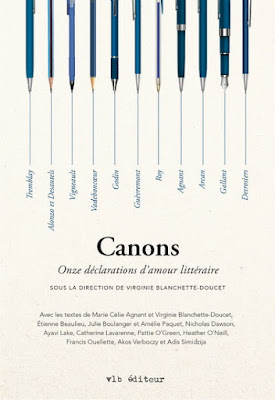J’AI SOUVENT LU des romans qui m’ont entraîné dans le Grand Nord québécois, cette partie du pays que l’on nomme le Nunavik. La plupart du temps, ce sont des textes signés par des résidents du Sud qui vont travailler pendant quelques années dans le refuge du froid. Du moins, c’était ainsi, il n’y a pas si longtemps, avant les bouleversements climatiques. Beaucoup d’enseignants qui s’exilent et se butent à une réalité qu’ils avaient du mal à imaginer avant de descendre de l’avion et de se présenter dans une classe. Impossible d’œuvrer comme on le fait à Montréal ou à Alma. Les jeunes pensent autrement et ils n’ont pas totalement oublié la liberté qui était la leur avant l’école. Certains coopérants n’arrivent pas à s’adapter et d’autres parviennent à négocier un pacte avec eux, à vivre une forme de paix fragile. Felicia Mihali, Juliana Léveillé-Trudel, Jean Désy, la liste pourrait s’allonger. À vrai dire, ça me plaît bien de m’aventurer dans un ouvrage signé par quelqu’un qui nous présente l’envers du décor. Qimmik de Michel Jean se risque dans cette aventure.
Michel Jean est une figure de proue dans le monde littéraire du Québec avec ses romans qui font la joie de milliers de lecteurs ici et un peu partout à l’étranger. Qimmik, (un mot inuktitut qui signifie un chien ou une race canine) nous entraîne dans des événements terribles qui ont marqué les gens de ce territoire et changé leur façon d’appréhender l’espace.
« Sur ce continent longtemps oublié, les humains vivent avec leurs qimmiit, leurs chiens. Des chiens gros, forts, résistants et fidèles. Depuis cinq mille ans, l’inuktitut et le jappement des qimmiit résonnent dans le Nunavik. La vie y est cruelle. Mais c’est ce qui la rend belle. Précieuse. » (p.14)
Pour une fois, nous nous aventurons dans le quotidien des Inuit qui subsistaient naguère de la chasse et de la pêche. Michel Jean nous permet de suivre Saullu et Ulaajuk, un jeune couple, des nomades qui fuient Kuujjuaraapik. La petite agglomération connaît de grands bouleversements depuis que les Blancs du Sud ont découvert que cette portion du pays était importante. Un chamboulement survenu après la Deuxième Guerre mondiale.
Les deux vivent selon des traditions millénaires et un savoir appris des parents dès leur plus jeune âge. Ils font preuve d’ingéniosité et de patience pour manger tous les jours et avoir des vêtements chauds qui les protègent pendant des hivers à glacer le sang. Ils peuvent aussi, de temps en temps, compter sur la chance.
SOLITUDE
Les deux s’enfoncent dans la toundra, s’éloignent des rives de la baie d’Hudson avec leurs chiens qui sont de vrais partenaires dans toutes leurs entreprises. Sans eux, ils ne pourraient repérer les trous où viennent respirer les phoques à la surface et que la neige dissimule. Impossible non plus de se déplacer sur de longues distances sans eux. Ils peuvent même retrouver leur refuge dans une tempête où le ciel se confond avec le sol.
Nous les accompagnons dans ce territoire fascinant, magnifique et j’ai eu souvent l’impression d’être à côté de Saullu quand elle passe des heures, parfaitement immobile, attendant la remontée du phoque ou encore de suivre Ulaajuk dans ses expéditions, d’encourager l’attelage à avancer pendant les heures de cette journée si courte.
Ils bougent dans la beauté et la splendeur de ce coin de pays si mal connu, filant tout droit en longeant l’horizon on dirait. Et que dire de cette secousse sismique qui ébranle le ciel et le sol dans sa course ? Une sorte de brouillard qui flotte sur la plaine avec un bruit de commencement du monde.
« Une mer vivante et grouillante. Cinq mille ? Huit mille ? Dix mille caribous les bois au vent ? Combien de cœurs battent au même rythme devant moi ? Aucun autre animal sur terre, à part les humains peut-être, ne ressent le besoin de vivre en communauté nombreuse au sein d’une nature austère. Ce troupeau parcourt la toundra depuis la nuit des temps. Ce territoire est le sien. » (p.128)
Michel Jean a eu la bonne idée de faire coïncider deux grands moments de l’histoire du Nord. Celle d’avant les Blancs d’abord, les tâches de la vie traditionnelle et nomade, les activités de chasse et de pêche, les déplacements constants avec les chiens, les travaux de préparation des peaux, le tannage, la confection des vêtements, des bottes, les mitaines qui occupent toutes les heures et les saisons.
SÉDENTARISATION
Tous doivent se plier à la sédentarisation dans des villages qui ne répondent pas aux aspirations des familles. Ils doivent accepter les manières de faire du Sud, leurs matériaux et des maisons où ils étouffent. Ces deux manières de confronter le réel se sont imposées dès les premiers contacts entre les arrivants de France et les autochtones. La paroisse, le défrichage de la terre, l’agriculture et l’élevage opposés à la mouvance dans les forêts selon les saisons, le long des rivières qui permettaient d’aller un peu partout. Ce n’est pas pour rien que les coureurs des bois avaient si mauvaise réputation. Deux visions du monde qui se sont heurtées à l’époque de la Nouvelle-France. Oui, l’histoire s’est reproduite dans le Nord quand les gens du Sud ont décidé de s’approprier des territoires dont personne ne voulait, il y a si peu de temps.
La venue des Blancs a été une malédiction et une véritable catastrophe pour ces nomades. La plus sauvage des conquêtes et un colonialisme aveugle qui s’est imposé de façon unilatérale. L’épopée du Nord est une tragédie que l’on ignore et qui se perpétue malgré toutes les informations et les dénonciations. Les interventions des entreprises minières qui n’ont laissé que déchets et rebut après leur départ. De ces projets qui ont noyé une partie du territoire ?
Tout cela près de chez nous, au début des années cinquante, quand je me débattais dans les corridors de l’enfance et que j’apprenais à la dure ce qu’était l’autorité et les règles à la petite école.
Toujours la même approche.
Le conquérant se sent l’obligation de civiliser ces populations et de les faire entrer de force dans la modernité, la productivité et l’exploitation des ressources naturelles sans se soucier des traditions des peuples premiers. Sans les consulter bien sûr ! Et que dire des barrages de La Grande avec le recul ? Nous avons bien eu l’entente de la paix des Braves avec les Cris, mais les Inuit ont été oubliés dans ce pacte et n’ont pas réussi à dicter leur vision des choses alors.
« Les chasseurs cris avaient dit vrai. Peut-être qu’au fond mon esprit refusait d’accepter cette réalité. Je n’en veux pas aux Inuit qui vivent ici maintenant. Ils n’ont pas eu d’autre choix que de venir. J’en veux à ceux qui ont décidé cela. Ceux qui vivent loin d’ici et nous imposent leur monde. Ce n’est pas le mien. Ce n’est pas le nôtre. Toutes ces personnes qui s’entassent les unes sur les autres sont-elles aussi effrayées que moi ? Nos chiens hurlent, mais aucun qimmik ne leur répond. Où sont-ils ? » (p.170)
Et pour parvenir à les sédentariser, la police a abattu les chiens. Une véritable tragédie, un carnage. Les Américains ont fait la même chose pour soumettre les tribus de l’Ouest qui vivaient près des grands troupeaux de bison. Ils ont massacré ces bêtes jusqu’à les éliminer presque. Après, les autochtones ne furent plus que l’ombre d’eux-mêmes et ils durent se résoudre à la mort lente dans des réserves.
« Un jour quatre agents sont venus chez nous avec leurs armes, comme si nous étions des criminels. Ils ont abattu nos chiens devant mon père et moi. L’un après l’autre. Nous étions paralysés, mais eux rigolaient. Ils faisaient des blagues. J’imagine que pour eux ce n’était rien d’important. Mon père les regardait et, moi, j’avais le goût de vomir. Ils ont tué tous nos chiens en riant. Puis ils sont allés chez les voisins. Je les ai suivis pour les avertir, mais ça n’a rien donné. La douleur que j’ai ressentie ce jour-là fait partie de moi. Je vis avec elle chaque jour. Et c’est intolérable. Ils étaient quatre de la Sûreté du Québec. Ils ont osé rire. Ils ne rient plus maintenant. On est quittes. » (p.176)
Un roman bouleversant, terrible de justesse et de beauté. Michel Jean a eu la bonne idée d’évoquer la tragédie de ceux et celles qui doivent venir à Montréal, la plupart du temps pour des soins dans les hôpitaux, et qui n’ont pas d’argent pour retourner dans leur pays. Ils se retrouvent à la rue, totalement démunis et perdus, inutiles et vulnérables, dépossédés de tout leur passé et sans avenir. Une actualité épouvantable et choquante. Une quête d’identité aussi pour Ève qui a été adoptée par une famille francophone et qui peut, à cause de son métier d’avocate, défendre les siens. Particulièrement un Inuit accusé du meurtre d’anciens policiers de la Sûreté du Québec.
Michel Jean a trouvé le ton et surtout la retenue nécessaire pour sensibiliser le lecteur à cette tragédie qui a eu lieu dans un coin du Québec sans que nous en ayons pris conscience vraiment. Bien sûr, les écrivains parlent de drames, d’alcoolisme, de drogues, de violence, mais qui est à la source de tout ça ? Pourquoi les Inuit sont déboussolés et ne savent plus que faire de leur vie ? Il faut des voix comme celle de Michel Jean pour le dire, l’expliquer, mettre le doigt sur des malheurs effroyables et, et des comportements que nous avons du mal à reconnaître.
JEAN MICHEL : Qimmik, Éditions Libre expression, Montréal, 224 pages.
https://editionslibreexpression.groupelivre.com/blogs/auteurs/michel-jean-jean1062