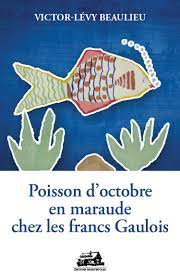ALTO VIENT de publier la traduction d’un recueil de nouvelles de Mariana Enriquez, Les dangers de fumer au lit. Cette auteure d’origine argentine en est à son troisième ouvrage. Elle a fait beaucoup parler d’elle avec Notre part de nuit. Une découverte, ces textes un peu étranges qui nous entraînent dans l’univers magique exploré par nombre de romanciers sud-américains. Un milieu où tout se mélange, où tout est vrai et concret, où les disparus se glissent dans le quotidien des vivants. Cela m’a rappelé des souvenirs d’enfance. J’ai grandi dans un monde où les morts pouvaient revenir donner des leçons à leurs progénitures, surtout s’ils n’aimaient pas la manière dont ils géraient leur héritage. Mes oncles et mes tantes racontaient plein d’histoires du genre et cela m’impressionnait énormément. Ils étaient attachés à leurs biens matériels, ces disparus. Surtout, il me semble qu’ils étaient particulièrement susceptibles. Les ancêtres ne laissaient pas aller leurs enfants comme ça, même après avoir déménagé au cimetière. Des apparitions et des anecdotes qui m’ont poussé à l’époque dans de terribles frayeurs.
Une douzaine de textes ramènent des morts qui se mêlent au quotidien des gens tout naturellement dans le monde de Mariana Enriquez. L’écrivaine nous entraîne dans des situations étranges et cauchemardesques. Des disparus perturbent les activités de certaines familles et imposent des idées ou des manières d’envisager les choses. Ils me paraissent bien têtus et peu sympathiques. Voilà une confrontation entre un passé statique et immuable et un présent que les personnages de madame Enriquez tentent de faire muter pour le meilleur ou le pire. Les enfants ne peuvent disposer de ce passé comme bon leur semble et l’héritage devient très lourd sur leurs épaules. Cela peut expliquer le conservatisme de certaines sociétés et la difficulté de changer des façons de faire ou de s’opposer à des régimes politiques néfastes.
« Jusqu’à cet instant je ne savais pas qu’il s’agissait d’Angelita, la sœur de ma grand-mère. Je continuais de fermer les yeux bien fort pour qu’elle disparaisse ou que je me réveille. Comme ça ne marchait pas, j’ai tourné autour d’elle et découvert dans son dos, pendues aux restes jaunâtres de ce qui était, je le sais maintenant, le suaire rose, deux petites ailes rudimentaires en carton avec des plumes de poule collées. Depuis toutes ces années elles auraient dû se désagréger, me suis-je dit, et j’ai ri, un peu fébrile, en songeant qu’il y avait un bébé mort dans ma cuisine, que c’était ma grand-tante et qu’elle marchait, même si d’après sa taille elle n’avait dû vivre qu’à peine trois mois environ. Il fallait une bonne fois pour toutes que j’arrête de réfléchir en termes de possible ou pas. » (p.15)
Un monde où les protagonistes (disparus et descendants) doivent trouver une façon de se voisiner et de s’entendre. Pas de craintes, de peur incontrôlable, de panique, mais une cohabitation naturelle, je dirais, obsessionnelle qui peut devenir cauchemardesque.
Une manière de mettre le doigt sur de terribles problèmes sociaux et politiques qui étouffent les narrateurs de ces histoires. Nous voilà à un autre niveau de compréhension et j’ai dû oublier les balises de la raison pour suivre cette écrivaine dans un réel où les frontières s’abolissent.
Des jeunes disparaissent et réapparaissent, errent dans les rues et les parcs, un véritable fléau. Les filles tombent entre les pattes de proxénètes et finissent de la pire des façons. Ce qui ne les empêchent pas de ressurgir dans Les petits revenants où elles terrorisent les vivants, leur reprochant peut-être de les avoir abandonnées.
FATALITÉ
La mort frappe partout et souvent. Voilà une fatalité contre laquelle il n’y a pas grand-chose à faire. Les malédictions aussi qui s’imposent et font en sorte que les vivants restent prudents et doivent ménager la susceptibilité des revenants.
Je me souviens des craintes qui hantaient mon enfance. Nous devions réciter des prières pour les disparus, un certain nombre de chapelets et payer des messes pour les apaiser et sauver leur âme, sinon nous n’en avions pas fini avec eux. Tout comme il ne fallait jamais se moquer d’un quêteux et surtout ne jamais lui refuser « la charité », si modeste soit-elle. Ma mère prenait des risques terribles. Elle ne se montrait guère généreuse avec ces hommes qui surgissaient une fois ou deux par année pour frapper à toutes les portes de la paroisse. Elle offrait toujours un sou noir, un seul que je devais mettre dans la main du visiteur. J’en tremblais de peur et de crainte. Le pauvre hère marmonnait et j’étais certain qu’il nous lançait une malédiction. L’étable passerait au feu pendant la nuit ou encore j’attraperais la polio et verrait mes jambes s’atrophier. Ma mère n’a jamais donné plus qu’un sou à ces quêteux qui ne s’attardaient jamais à la maison. Je comprends maintenant pourquoi ils couchaient toujours chez un voisin.
INQUIÉTANT
La nouvelle la plus étrange est certainement Viande où les mots sont pris au pied de la lettre. Je me suis retrouvé dans un monde sordide. Deux jeunes filles, de vraies groupies, écoutent toutes les mélodies d’un chanteur populaire. Surtout, elles interprètent ses textes comme si c’était la vérité absolue et ne passent jamais au niveau de la métaphore.
« L’après-midi, l’information filtra dans la presse. Deux adolescentes avaient déterré le cercueil de Santiago Espina avec une pelle et leurs propres mains. Un mois à peine après les funérailles, il n’y avait pas encore sur la sépulture le marbre définitif qui leur aurait compliqué la tâche. Mais l’exhumation n’était rien. Les filles avaient ouvert le cercueil pour manger les restes d’Espina avec dévotion et répugnance ; autour du trou, des flaques de vomi témoignaient de leur effort. » (p.115)
Tout cela pour obéir à une exhortation du chanteur qu’elles prenaient pour une sorte de prophète.
« Et elles écoutaient la dernière chanson de Viande (où Espina susurrait “Si tu as faim, mange mon corps. Si tu as soif, bois mes yeux”), rêvant du futur. » (p.117)
L’écrivaine nous pousse dans l’horreur et l’innommable. La plupart du temps, heureusement, ces nouvelles ouvrent une porte sur un imaginaire déstabilisant. Tout cela pour nous faire comprendre que la réalité se niche autant dans le surnaturel que le concret, que le langage porte à la fois le dégoût et la beauté. On ne sait jamais sur quel pied danser avec elle.
Et quelle conteuse remarquable que Mariana Enriquez ! Elle m’a entraîné là où elle le souhaitait avec une habileté déconcertante. Le souffle et la justesse de son écriture m’ont poussé dans des mondes qui m’ont laissé pantois. Très inhabituel pour nous qui avons tout misé sur la raison, mais combien fascinant quand on s’abandonne à toutes les dimensions du possible, que l’on se permet de fouiller les recoins de nos peurs et de nos phantasmes !
Mariana Enriquez franchit les limites de la réalité et ses détraqués, ses revenants et ses obsédés donnent froid dans le dos. Et vous voulez savoir pourquoi ce titre ? Il vous faudra vous pencher sur l’avant-dernier texte pour tout comprendre. Allez, plongez dans le pays de l’étrange, de l’imaginaire et oui, parfois, de l’horreur. Mais ce n’est jamais gratuit, vous verrez, il y a toujours un questionnement et une hésitation qui flottent et s’imposent après la lecture de ses nouvelles. C’est ce qui m’a fasciné.
ENRIQUEZ MARIANA, Les dangers de fumer au lit, Éditions Alto, Québec, 200 pages.