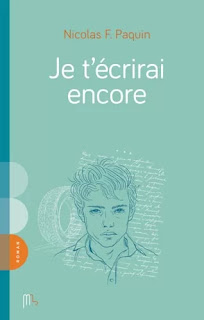« LA LEVÉE » de David Bergeron nous présente une famille bien d’ici qui profite de la campagne, d’un chalet, d’un « campe » au milieu d’une pinière, tout près d’un point d’eau. Le rêve de bien des citadins. Un lieu paisible où ils peuvent bénéficier de la nature pendant quelques jours en été. Tout le clan s’y trouve pour des vacances, des fêtes où les enfants peuvent se faufiler entre les arbres, s’inventer des jeux où ils deviennent des héros. Pas trop loin, bien sûr, juste pour ne pas ressentir le regard des parents et s’imaginer qu’ils sont capables de toutes les prouesses. Un lieu de retrouvailles, de repos où les hommes boivent de la bière en plaisantant pendant que les femmes surveillent discrètement les jeunes en profitant du soleil et de la douceur des jours qui se prolongent. Bergeron propose une histoire comme il ne s’en fait plus et m’a tenu en haleine du début à la fin de ses 180 pages.
Des familles tissées serrées malgré des ruptures et des amours qui claudiquent. Marie-Claire est seule avec son fils Rémi. Le père a disparu sans laisser d’adresse. Jean, son nouveau compagnon, un travailleur de la construction, un ami de la forêt et un chasseur, fait son possible même s’il a un problème avec l’alcool. Le trio tente de former une famille. Rémi s’attache à Jean, malgré son silence et ses fréquentes escales à la taverne d’où il revient plus mort que vivant.
Tous prennent du bon temps dans cette forêt que les grands-parents ont imaginée et aimée, plantant des pins qui sont devenus magnifiques.
Jean pensait initier Rémi à la chasse malgré les craintes de Marie-Claire. Les deux s’enfoncent dans le bois qui les accueille pendant une journée calme et parfaite. Les arbres semblent plus grands que d’habitude pour le petit garçon, un peu inquiétants quand une poussée de vent brasse les branches et provoque des bruits étranges. Les bêtes se sont déplacées pendant la nuit où tous les fantasmes circulent et laissent des empreintes dans la boue. Le jour, orignaux et chevreuils savent devenir invisibles.
« Il y avait en ces bois une beauté que nulle part ailleurs je ne retrouvais, une quiétude à ciel ouvert, une solitude qui n’avait pas besoin de se cacher entre quatre murs. Cette forêt, c’était moi, libre, heureux comme on l’est d’une enfance qui ne nous a pas encore trahis ou laissés tomber. Et je lisais aussi ce bonheur dans les yeux de ma mère. Elle portait, l’été, de grandes robes colorées qui flottaient dans l’air. Elle riait sans raison, simplement d’être là, avec moi, le chien Finn et lui, Jean, son chasseur. » (p.11)
Rémi raconte d’abord les jeux, la joie d’être dans sa famille avec des cousins. Des moments de l’enfance où l’on a l’impression que les jours n’ont pas de fin et que le temps s’est allongé dans une clairière. Je garde des souvenirs extraordinaires de nos séjours dans un camp au milieu de la forêt, près du grand lac Pémonka et de la rivière Ashuapmushuan. Ce sont des petites éternités de bonheur, l’espace parfait où se nichait la liberté, la paix et la vraie vie avec parfois une rencontre avec un ours ou un orignal.
DRAME
Jean et Rémi s’enfoncent dans la forêt, s’attardent ici et là, prenant le temps de respirer sur une colline ou près d’un ruisseau, de boire l’eau froide et vivifiante. Et ils se penchent sur des traces, celles d’un chevreuil qui a circulé entre les arbres, dans ce domaine qui est le sien, même s’il y a le danger pour un cervidé avec les prédateurs aux aguets.
Jean met le pied dans un piège abandonné et les dents d’acier lui coupent la cheville presque. Rémi s’affole pendant que Jean tente de se défaire du piège, fonce droit devant pour aller chercher de l’aide. Mais comment un petit garçon de dix ans qui ne connaît rien à la forêt peut-il suivre la piste qu’ils ont empruntée depuis le matin ? Il s’égare rapidement.
« Il était difficile de presser le pas entre les arbres et, même sans courir, j’avais le cœur qui battait sans cesse la chamade. Je tirais nerveusement sur ma bombe de Ventoline et je dus me reposer un moment, assis sur une pierre, penché en avant en me tenant les côtes. Mes mains tremblaient, je les plaçai sous mes aisselles pour apaiser leur tourment. Quand je relevai la tête, je surpris un lièvre en train de me regarder. Ses yeux étaient des billes d’émeraude. Il était à quelques mètres de moi, immobile, les oreilles dressées et le nez remuant à peine. Je me dis qu’enfin Dieu se manifestait sous cette forme, avatar inoffensif, gracile, lunaire, et qu’il venait pour me guider hors de la forêt. » (p.78)
Rémi erra pendant sept jours, trouvant à boire et à manger, dormant sous les branches d’une épinette, cherchant des traces et des humains. Sept jours et autant de nuits en ne sachant où aller, avec la faim qui le tenaille et la soif. Il finira par aboutir dans une cabane à sucre abandonnée où il pourra faire du feu. Il ne sera pas au bout de ses peines pourtant. Le lendemain matin, il se retrouve devant une mère coyote en chasse pour nourrir ses petits.
Une aventure terrible qui laisse des traces et quelques cicatrices. Peut-être aussi des moments uniques et des heures où il a glissé dans une quiétude parfaite, celle de la forêt et de ses sortilèges.
RENCONTRE
Vingt ans plus tard, Rémi décide de renouer avec Jean, qu’il n’a jamais revu depuis le drame. Il sait que ce dernier vit en ermite au fond des bois, loin de tout et des villages qu’il supporte plutôt mal.
Il finit par rejoindre celui qui aurait pu être son père. Les deux hommes se retrouvent, un peu mal à l’aise, comme il se doit après une si longue séparation. Un grand moment de cette histoire, pour boucler la boucle et se rassurer. Les deux vident une bouteille et trouvent des mots pour se dire, se comprendre même s’ils suivent des sentiers différents.
« La lune survolait l’échine des Appalaches, et le monde brasillait doucement sous nos yeux. On buvait en silence, à même le pot Mason qui circulait patiemment entre nous et, si les minutes avaient repris leur cours, il me semblait enfreindre les lois de leur insécable nature pour les détacher les unes des autres, comme un émiettement de secondes que je laissais glisser entre mes doigts et qu’à ma guise, je pouvais contempler dans une clairvoyance absolue. D’invraisemblables secondes hors du temps, partagées entre celui qui n’était pas un père et moi qui n’avait plus besoin d’être un fils. Notre histoire se terminait ainsi. Sans rien dire sous la lune. Deux loups au bout de leurs hurlements. » (p.161)
Un magnifique roman où la forêt transforme les individus et calme leur mal être difficile à cerner. Un passage initiatique pour Rémi, l’enchantement du bois, qui peut être impitoyable pour ceux et celles qui s’y aventurent.
Le vrai personnage de ce roman de David Bergeron est la forêt avec sa grâce sauvage, étrange, fascinante et aussi le temps qui permet de devenir un meilleur humain. Elle peut sembler cruelle, cette forêt, mais elle est porteuse d’espoir et sait accueillir les marginaux sans les juger. Rémi a vécu une apothéose lors de sa semaine d’errance et cela, il ne pourra jamais l’oublier.
« Et même si j’étais terrifié à l’idée de revenir en forêt, même si j’ai cru que j’allais mourir quand le coyote m’a attaqué, j’avais trouvé ça beau, être perdu. Le ciel. Mon Dieu, Jean, le ciel. Même au village, y avait rien qui s’approchait du ciel comme je l’avais vu certains soirs, tissé d’étoiles, les nébuleuses comme du lait renversé, la profondeur de l’espace, comme des strates et des strates de noir qui se superposaient les unes aux autres de teintes qu’on soupçonne jamais, l’encre, le carbone, la fumée, la réglisse. Je retrouvais plus rien de ça dans notre maison de la rue Saint-Jean-Baptiste, juste le plafond de ma chambre, la télé, pis ma mère qui se sentait tellement coupable de m’avoir donné la permission de le suivre dans le bois. » (p.153)
Vingt ans plus tard, ils parviendront à faire la paix et à se comprendre. Le regret ou le remords d’avoir abandonné Jean en fuyant. Certainement aussi, l’imprudence de Jean qui l’a entraîné dans cette aventure.
Les deux hommes n’ont pas grand-chose à se dire, sauf de partager leur amour pour le calme et le silence. Pourquoi secouer des mots ou de longues phrases pour décrire le bien-être et la joie qui les enveloppe ?
Un texte fascinant, avec une présence de la forêt, des bêtes qui sont toujours un enchantement lorsque je parviens à en surprendre une, du bois qui a quelque chose des églises où nous attend la tranquillité qui fait oublier le monde et ses terribles turpitudes. Une écriture du regard, de la contemplation, où l’aventure se dit dans sa plus simple expression, soit à l’intérieur de soi quand on prend la peine de s’arrêter et de devenir des yeux et une respiration devant la beauté ?
BERGERON DAVID : « La levée », Éditions Mains libres, Montréal, 2025, 180 pages, 27,95 $.
https://editionsmainslibres.com/livres/david-bergeron/la-levée.html