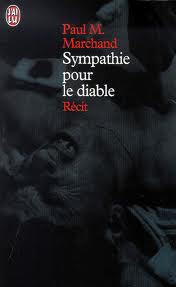Denise Desautels est restée longtemps fidèle à la poésie avant de faire le «saut de l'ange» et aborder la prose. «Le bonheur, ce fauve» récit d'enfance et d'introspection, est un regard touchant, juste, très sobre sur les années qui marquent la vie et forgent l'adulte. Avec ce récit d'initiation, ces réflexions sur ces moments de l'enfance qui surgissent comme une bulle à la surface de l'étang, Denise Desautels sait se faire inquiétante avec la mort qui se faufile entre deux gestes, deux longues respirations. Cette mort qui devient obsédante avec un père arraché à l'auteure quand elle n'avait que cinq ans. Cette «présence» ponctue le récit, accompagne les rires, se profile le soir, au bout d'un jour exceptionnel de juillet, emprunte le souffle «des âmes voyageuses» et vient inquiéter l'enfant dans son émerveillement du monde.
Tout s'est arrêté le six mai 1950 et après une éternité, une seconde peut-être, la vie est repartie.
Un monde
Dans de courts chapitres, comme si le lecteur feuilletait un album de photographies anciennes, Denise Desautels nous encercle avec son monde, ses rêves, ce «père absent» qui ne s'éloigne jamais malgré la vie ou la mort. Elle reste marquée, troublée, perturbée, surtout que la mère met sa vie en veilleuse et semble attendre d’impossibles retrouvailles. La vie ne peut plus être insouciante, ne saura jamais être insolente et pleine de certitudes. Toujours il y a cette gravité qui s'approche quand tout prend la couleur du bonheur. Parce que l'auteure sait. «J'apprends très tôt qu'il n'y a pas d'âge pour mourir» (p.158).
La mort se faufile dans ce qui est le plus intime, le plus chaud et le plus vorace. Elle donne un poids à la vie et la rend plus précieuse même. Mais comment s'empêcher de basculer du côté des vivants malgré la peur, la fragilité du corps qui peut oublier ses gestes au mitant du jour... Denise Desautels murmure à l'oreille. C'est la confidence, la respiration, le monde protégé de la chambre, le rire devant un lac qui s'embrase de l'été, le matin chaud dans les draps qui forment le corps. Et c'est un souffle encore, un sourire, un effleurement, comme si les anges du si beau film de Wim Wenders venaient partager des secrets, des espoirs, des rires et des larmes. Le monde devient un livre retrouvé qui s'ouvre et se referme, une phrase qui remonte à la surface. Le récit retient son souffle, fige la course du lecteur dans un moment de grâce et d'inquiétude. Qui n'a pas ressenti que tout pouvait basculer au milieu d'une journée parfaite de juillet, quand il n'y a que de l'eau et des excès de chaleur? La vie est si fragile et la mort si fidèle.
L’instant précieux
Un geste, un élan, un regard, un sourire, un amour fragile et la vie s'affole en perdant ses ailes, n'est plus qu'une palpitation, qu'une paupière qui efface la réalité du monde et la retrouve, un battement à la naissance du cou et un sourire qui frémit sur les lèvres. La vie devient si lente alors, si douce que le temps peut s'éloigner et oublier. Tout dans ce récit est de l'ordre du frisson et du tremblement.
Le monde fragile de l'enfance est défait et reconstitué dans la mémoire qui en redessine les contours. Les mots serrent la gorge et la parole devient râpeuse. Il faut rebrousser chemin alors mais comment s'empêcher de revenir... Denise Desautels traduit bien ces hésitations, ces moments purs d'émotion en passant du je au il, prenant ainsi le recul essentiel pour comprendre et toucher la blessure.
«L'enfant, absorbée par l'inconnu, éprouve la vie comme un frisson. Elle n'est plus qu'une peau souple et frémissante qui se laisse prendre par le goût de l'air. De la caresse. On l'a ensorcelée» (p.29).
L'auteure ne triche pas, ne laisse jamais croire qu'elle revit son enfance. Nous savons que c'est l'adulte qui regarde et se souvient. Toujours le moment évoqué garde ce flou, ce halo, cette patine du temps. Juste la trace de l'ongle qui marque un peu l'être et l'âme. Un récit tout en finesse, en délicatesse, une écriture faite de pudeur et d'audace.
«Ma mère. Ses doigts câlins, je le devine, flânent sur un cou, glissent sur une épaule, hésitent, ralentissent leur descente, s'arrêtent quelques instants sur un coude, surveillant là la prochaine maison, puis avec langueur redémarrent, «quarante-trois»... dévient vers l'intérieur, se resserrent à la saignée d'un bras et font des cercles lents, très lents sur une peau qui frissonne» (p.140).
Et à la fin, quand on a épuisé toutes les pages, il faut fermer les yeux pour se rappeler ce rideau qui tremble, ce matin à la lumière délavée avec des oiseaux qui attendent; le soleil fou qui traîne son ombre au milieu d'un lac, l'été des amours, les rires et le bonheur de l'adolescent Louis qui ne croyait plus à la mort malgré la maladie qui le rongeait.
Le souvenir fait frémir les lèvres, esquisser un mouvement de danse et c'est ce vêtement qui colle à la peau gorgée de soleil. L'oncle Bernard ferme les yeux et pense à voix haute. La musique ne devrait jamais s'arrêter. Peut-être que la vie n'aura plus la mauvaise idée de bousculer les êtres aimés, peut-être que le monde sait être prodigue de son temps...
«Ce fauve, le bonheur» de Denise Desautels est paru à L'Hexagone.
 Le lecteur était en droit de s'attendre à une «connaissance» de l'époque puisque nous passons par Bagdad, Marrakech, empruntons les grandes routes où les caravanes, en plus des produits, font circuler les idées. Malheureusement, Jean-Louis Roy évite le sujet. Jamais il ne traduira le contenu de ces rencontres, n'osera les imaginer ou ne se risquera à rêver le monde que traverse le Kankan Moussa. Il reste en retrait, se répète dans de vagues descriptions, s'attarde sur des Mosquées, des palais et il ne dit rien de plus que ce que pourrait révéler un guide touristique. Le lecteur est gardé hors du voyage initiatique et le récit devient vite sans intérêt et répétitif. Si le Kankan Moussa a été transformé par des rencontres, des discussions, en tant que lecteur, je n’en ai rien su et c’est fort décevant.
Le lecteur était en droit de s'attendre à une «connaissance» de l'époque puisque nous passons par Bagdad, Marrakech, empruntons les grandes routes où les caravanes, en plus des produits, font circuler les idées. Malheureusement, Jean-Louis Roy évite le sujet. Jamais il ne traduira le contenu de ces rencontres, n'osera les imaginer ou ne se risquera à rêver le monde que traverse le Kankan Moussa. Il reste en retrait, se répète dans de vagues descriptions, s'attarde sur des Mosquées, des palais et il ne dit rien de plus que ce que pourrait révéler un guide touristique. Le lecteur est gardé hors du voyage initiatique et le récit devient vite sans intérêt et répétitif. Si le Kankan Moussa a été transformé par des rencontres, des discussions, en tant que lecteur, je n’en ai rien su et c’est fort décevant.